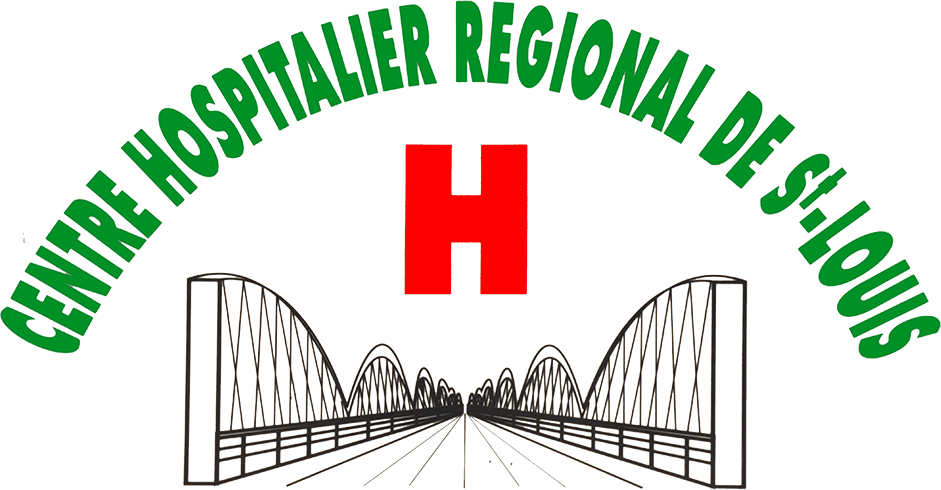La mise en œuvre de la réforme se caractérise par un contexte de changement avec l’introduction des notions structurantes de qualité des prestations, de logique, de performance, d’autonomie de gestion, de personnalité juridique, de transfert de compétences et ancrage institutionnels multiples.
Une nouvelle structure d’objet en découle, la mission de service public demeurant cependant en l’Etat.
Des mesures administratives, financières et comptables et des outils de gestion ont été élaborés et mis en place dans tous les établissements. Leur mise en œuvre induit des pratiques plus transparentes en matière de gestion.
Les procédures et outils de gestion ont été développés par des experts en gestion qui ont produit :
- un manuel d’organisation des hôpitaux ;
- un manuel de contrôle de gestion ;
- un manuel de procédures administratives, financières et comptables ;
- un manuel de procédures des ressources humaines ;
- un plan comptable hospitalier ;
- un système d’information médical ;
- un schéma directeur informatique.
Des projets d’établissements ont été élaborés par les hôpitaux. Ils représentent un plan stratégique de développement défini à partir d’une analyse de l’existant. Ils permettent de projeter l’hôpital dans l’avenir, de développer un esprit d’équipe, de susciter une motivation du personnel en l’associant à la définition de la stratégie de l’hôpital.
La réforme tient compte de la récente loi sur la décentralisation qui donne aux collectivités locales de nouvelles prérogatives en matière de gestion des établissements de soins. Dans ce cadre, le président du Conseil Départemental est de droit président du Conseil d’Administration de l’établissement situé dans sa région. Il propose également les quatre personnalités siégeant au conseil.
L’Etat et les collectivités locales apportent aux hôpitaux les dotations qui leur permettent de remplir leurs missions, en particulier de traiter les urgences et de maintenir les tarifs à un niveau acceptable. Les usagers participent aux dépenses d’hospitalisations et de consultations externes.
Pour conduire les changements institutionnels et managériaux nécessaires, une direction des établissements de santé a été créée sous forme de projets appuyés par des fonds ; elle est chargée entre autres tâches de recruter et de former des cadres de gestion qu’elle met à la disposition des EPS.
A: Au plan institutionnel et organisationnel
De nouveaux services sont crées dans les hôpitaux : un service de soins infirmiers et un service Administratif et financier. En outre, un agent comptable est nommé de même qu’un contrôleur de gestion.
Les principaux organes mis en place par la réforme sont : le Conseil d’Administration (CA), la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et le Comité Technique d’Etablissement (CTE).
- Le Conseil d’Administration
Le CA comprend des représentants de l’administration, des représentants des collectivités locales, des représentants des professions médicales et pharmaceutiques, des personnalités qualifiées et des représentants des organismes de prévoyance sociale. Egalement le personnel est représenté dans le conseil sans oublier les représentants de la population.
Le CA arrête et adopte le budget de fonctionnement et d’investissement. Il délibère sur le budget, les comptes prévisionnels, les comptes de fin d’exercice ainsi que sur les emprunts. Ainsi il fixe le tarif des prestations dans une fourchette de prix établie par l’administration.
- La Commission Médicale d’Etablissement
Cette commission est présidée par un médecin qui collabore étroitement avec le Directeur. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux soins et assure la promotion de l’évaluation de la qualité des soins au sein de l’établissement. Elle met un accent particulier sur la responsabilisation des médecins.
- Le Comité Technique d’Etablissement
Outre le représentant des médecins, y siège un membre de chaque catégorie du personnel élu par ses pairs. Le directeur de l’hôpital préside le comité technique d’établissement. Cette instance consultative a pour rôle de faire participer le personnel technique à la résolution des problèmes touchant à l’hygiène, à la sécurité, au plan de formations.
Avec l’adoption de la réforme hospitalière, les hôpitaux sont structurés comme une entreprise au plan institutionnel et organisationnel. En effet, sur le plan institutionnel, les hôpitaux ont acquis une autonomie de gestion avec en plus des organes consultatifs pour l’organisation administrative et financière afin de rendre un service public à moindre coût. Le directeur nommé par décret jouit d’une grande liberté dans l’exécution de son programme. Il est soumis au contrôle du Conseil d’Administration. Ainsi, le Président du Conseil opère un contrôle à priori sur les fonds, avant le vote du budget, et un contrôle à postériorité portant sur les réalisations.
B: Au plan managérial:
Par le management, les hôpitaux cherchent à atteindre un objectif précis en se focalisant sur les ressources humaines et matérielles. A cela s’ajoute la combinaison harmonieuse de 6 éléments bien définis à savoir:
- Le relèvement général des niveaux de compétences par une politique volontariste de développement de savoir faire centré sur la qualité des soins et des performances de gestion.
- Le renforcement de la structure organisationnelle par la responsabilisation des travailleurs.
- Une politique globale de communication initiée, planifiée par le staff et mise en œuvre sur la base des divers supports de communication pour une proximité avec les populations.
Aussi, les usagers et les travailleurs peuvent s’exprimer en toute liberté sur les questions les concernant lors des tribunes radiophoniques. Ces dernières servent aussi à vulgariser des informations, à promouvoir des changements de comportement ou à sensibiliser sur les questions en relation avec le domaine de la santé.
C : Au plan financier
- Le budget de l’Etat et des Collectivités Locales
Le budget peut se définir comme étant un plan d’actions valorisé pour atteindre un objectif daté et qualifié.
En général l’objectif est établi sur une période d’un an qui correspond à la durée de l’exercice budgétisé.
Ainsi, comme dans plusieurs pays du monde, l’Etat du Sénégal dans sa politique de développement du secteur de la santé, alloue un budget à chaque établissement en fonction de sa catégorie. A travers cette politique, l’Etat a pour objectif de rendre les services de santé accessibles à toutes les couches sociales. C’est une politique qui permet de diminuer le coût des soins aux patients.
C’est dans ce cadre que les hôpitaux du Sénégal bénéficient chaque année d’une subvention de l’Etat et des Collectivités Locales. Cette subvention que l’Etat apporte aux hôpitaux représente 53 % de leur budget en moyenne. Le reste du budget de l’hôpital est constitué par les apports des populations pour 11 %, des collectivités locales pour 5 % et de partenaires pour 30 %.
- L’autofinancement
Les hôpitaux doivent être à mesure de pouvoir compter sur leurs recettes pour compléter le financement de ses projets. Car n’oublions pas que l’enjeu de la réforme est la délégation des pouvoirs de L’Etat aux hôpitaux pour que ces derniers deviennent autonomes au plan institutionnel, organisationnel mais surtout financier parce que l’Etat rencontrait beaucoup de difficultés dans la gestion surtout financière de ses hôpitaux. Les recettes des E.P.S doivent servir en principe à prendre en charge une partie de leur personnel et à combler les manquements financiers vu que le budget alloué par l’Etat n’est jamais suffisant.
3-Mission des établissements publics de santé
Les établissements Publics de santé Hospitaliers doivent assurer :
Une mission de service public : ils assurent à toutes les populations un accès équitable aux soins de qualité ;
Une mission spécifique qui tourne autour :
- Du traitement des malades et de la prévention de certaines maladies ;
- Du développement des Ressources Humaines ;
- De la recherche et de la vulgarisation de ses résultats dans le domaine de la Santé.